12/04/2016
Cruels itinéraires
 Iain Banks, Un chant de pierre, traduit de l’anglais par Anne Sylvie Homassel, gravures de Frédéric Coché, L’œil d’or, 2016
Iain Banks, Un chant de pierre, traduit de l’anglais par Anne Sylvie Homassel, gravures de Frédéric Coché, L’œil d’or, 2016
L’œuvre de l’écrivain écossais Iain Banks (1954-2013) relève de plusieurs genres : la science-fiction (sous la signature de Iain M. Banks), l’essai, la fiction. Un chant de pierre appartient à cette dernière catégorie – sous de fausses allures de réalisme historique mêlé de merveilleux sanglant et d’onirisme poétique.
Abel, le narrateur et protagoniste, aristocrate en butte à une guerre dévastant le pays et jetant la population sur les routes, fuit le domaine familial avec sa sœur-amante (à qui le récit s’adresse), avant d’être arrêté par une Lieutenant qui les ramène de force à leur point de départ, investit le château avec ses sbires et ne lâchera plus le couple, le séduisant et le séparant, provoquant un mélange d’attirance et de répulsion, de séduction et de cruauté. Une cruauté qui n’épargne personne, ni le peuple venu se réfugier sous les murailles, ni les soldats, ni les pillards, ni les domestiques, ni les maîtres ; la torture, la souffrance, la mort menacent chacun dans un conflit dont on ne perçoit ni les tenants ni les aboutissants, et auquel on participe à faible hauteur d’homme, comme Fabrice del Dongo à Waterloo. Un conflit à la fois moderne (il y a des jeeps, des pistolets, des grenades) et d’apparence médiévale (il y a des épées, des armures, des potences), dans lequel la nature végétale ou minérale et les constructions humaines (les pierres…) jouent des rôles importants, un conflit, surtout, à l’absurdité intemporelle : « Je ne comprends pas leur guerre, ne sais plus maintenant qui combat contre qui, ni pour quelle raison. Nous pourrions être à n’importe quelle époque, n’importe quel endroit ; n’importe quelle cause produirait les mêmes résultats, les mêmes fins, incertaines ou définitives, gagnées ou perdues. ». Un conflit qui donne des occasions de retours sur le passé, sur soi, sur la destinée : « Chacun d’entre nous contient l’univers dans son être, l’existence dans sa totalité contenue par tout ce dont il nous faut tirer du sens […]. Peut-être inventons-nous nos propres destins, de sorte qu’en un sens nous méritons ce qui nous arrive, n’ayant pas eu assez d’esprit pour nous figurer mieux. ».
Roman inclassable, entre fable (im)morale et conte fantastique, Un chant de pierre tient aussi du récit d’aventures, de la fantaisie morbide, du roman d’analyse, de l’érotisme sadien et de la parodie ducassienne, comme en témoignent certaines évocations qui mènent le lecteur sur des chemins inattendus : « Le matin arrive, radieux ; l’aube aux doigts de sang de sa lueur zélée incendie des océans célestes et courbe vers la terre un autre commencement factice. Mes yeux s’ouvrent comme des bleuets, se collent, encroûtés de leur propre rosée rance puis absorbent cette lumière. ». Roman poétique, pourrait-on dire, d’une poésie sans concessions, violente, oppressante, déroutante, fascinante.
Jean-Pierre Longre
17:50 Publié dans Littérature, Mots et images | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, anglophone, ilustration, iain banks, anne-sylvie homassel, frédéric coché, l’œil d’or, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
07/04/2016
« Alimenter le désir de vivre »
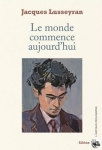 Jacques Lusseyran, Le monde commence aujourd’hui, Silène, L’artisan philosophe, 2012, Folio, 2016
Jacques Lusseyran, Le monde commence aujourd’hui, Silène, L’artisan philosophe, 2012, Folio, 2016
« Les deux miroirs brisés, les yeux continuent de vivre. Ceux dont je veux parler, les vrais yeux, travaillent au-dedans de nous ». Et plus tard, à propos des images et de la mémoire : « Celles-ci, les souvenirs, je les voyais aussi, mais dans ma tête, au niveau et de mon front et de mon cerveau. Celles-là, les choses vues, je les percevais beaucoup plus largement : dans l’ensemble de mon organisme ». Oui, à la suite d’un accident, Jacques Lusseyran (1924-1971) est devenu aveugle à huit ans. Mais une fois ces précisions données, il faut bien avouer que Le monde commence aujourd’hui n’est pas un livre sur la cécité. C’est un livre tout en clarté.
 S’il comporte un aspect autobiographique, le récit de vie est un support pour autre chose, qui tient à la fois du témoignage, de la réflexion et de la poésie. L’expérience dramatique du camp de Buchenwald n’est, par exemple, jamais misérabiliste, au contraire : elle est jalonnée de rencontres d’hommes à la fois ordinaires et admirables comme Jérémie, qui « trouvait la joie en plein bloc 57 », Louis, qui semblait « se chercher une famille », Pavel le Russe qui prenait la vie comme elle vient…
S’il comporte un aspect autobiographique, le récit de vie est un support pour autre chose, qui tient à la fois du témoignage, de la réflexion et de la poésie. L’expérience dramatique du camp de Buchenwald n’est, par exemple, jamais misérabiliste, au contraire : elle est jalonnée de rencontres d’hommes à la fois ordinaires et admirables comme Jérémie, qui « trouvait la joie en plein bloc 57 », Louis, qui semblait « se chercher une famille », Pavel le Russe qui prenait la vie comme elle vient…
La vie, c’est bien d’elle qu’il s’agit, à travers le regard intérieur porté sur soi et sur les autres. La vie du prisonnier, et aussi celle de l’enseignant, du conférencier qui doit éveiller son auditoire en restant lui-même éveillé aux autres. De quoi s’agit-il encore ? De la poésie, qui n’est pas seulement de la littérature, mais aussi « un acte », « une des rares, très rares choses au monde, qui puisse l’emporter sur le froid et la haine », et qui somme toute illustre parfaitement ce que réussissent à susciter la méditation active de Jacques Lusseyran (si bien suggérée par le portrait qu’en a fait Jean Hélion) et son écriture à la fois subtile, vigoureuse et apaisante : « Alimenter le désir de vivre ».
Jean-Pierre Longre
http://www.omalpha.com/jardin/lusseyran.html
 Jacques Lusseyran, Et la lumière fut, préface de Jacqueline Pardon, Folio, 2016
Jacques Lusseyran, Et la lumière fut, préface de Jacqueline Pardon, Folio, 2016
Présentation de l'éditeur:
En 1940, la France capitule. En 1941, Jacques Lusseyran, alors qu’il est aveugle et n’a pas dix-huit ans, entre en résistance en rejoignant le mouvement Défense de la France. Le 20 juillet 1943, il est arrêté par la Gestapo, interrogé pendant des jours interminables et enfermé à Fresnes. Il sera déporté en 1944 à Buchenwald. Comment un aveugle peut-il survivre à cet enfer? Grâce à la protection d’un groupe de Russes et à sa connaissance de l’allemand qui lui permettra d’informer les autres déportés des agissements des S.S. Après un an et demi d’horreur, il est libéré et revient en France où il poursuivra ses études en affirmant ses aspirations littéraires balayées par la guerre.
Cette autobiographie est un exceptionnel exemple d’amour de la vie, de courage et de liberté intérieure face à l’adversité.
15:03 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, récit, francophone, jacques lusseyran, silène, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
Clarté intérieure
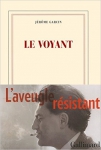 Jérôme Garcin, Le voyant, Gallimard, 2015, Folio, 2016
Jérôme Garcin, Le voyant, Gallimard, 2015, Folio, 2016
Jacques Lusseyran (1924-1971) a vécu hors normes : enfant choyé devenu accidentellement aveugle à huit ans, résistant actif alors qu’il était encore un brillant lycéen, arrêté puis déporté à Buchenwald, marié trois fois, professeur de littérature française aux États-Unis (les portes de l’Université française lui étant fermées depuis le régime de Vichy à cause de sa cécité), membre d’un ésotérique et étrange « Groupe Unitiste », conférencier à succès, séducteur invétéré, écrivain méconnu, mort prématurément dans un accident de la route, et finalement disparu dans les limbes de l’oubli littéraire…
 Tout cela est raconté, rappelé dans Le voyant, livre qui n’est pourtant pas une biographie ordinaire, qui est bien plus que cela. Le titre lui-même contient l’essence de ce dont il est question : Jacques Lusseyran a maintes fois expliqué « l’incroyable pouvoir qu’il avait tiré de son traumatisme originel » ; maintes fois montré « combien ce choc tellurique avait, en contrariant à la fois les idées reçues et les invariants scientifiques, déterminé toute son existence ; pourquoi enfin sa morale, sa philosophie de la vie, sa disposition au bonheur, son perpétuel besoin d’aimer découlaient naturellement de ce drame dont il n’allait cesser de faire une promesse et une chance. ». Aussi contradictoire que cela puisse paraître, il voit dans la cécité une source de courage dans les épreuves physiques et morales, un surcroît d’aptitude au bonheur, à l’amour, au désir, un insatiable appétit de vivre – et voici, très justement, ce qu’écrit encore Jérôme Garcin : « Du camp de Buchenwald, un homme sans regard, si maigre qu’il semble flotter dans sa tenue rayée et puis s’y noyer, a pu écrire : « J’ai appris ici à aimer la vie. » Même si l’on en comprend le sens – il a appris ici à refuser de mourir, à se battre pour survivre –, cette phrase n’a pas d’équivalent dans toute la littérature concentrationnaire. Elle explose, comme une bombe, à la tête de tous les bourreaux. Elle les tue. ».
Tout cela est raconté, rappelé dans Le voyant, livre qui n’est pourtant pas une biographie ordinaire, qui est bien plus que cela. Le titre lui-même contient l’essence de ce dont il est question : Jacques Lusseyran a maintes fois expliqué « l’incroyable pouvoir qu’il avait tiré de son traumatisme originel » ; maintes fois montré « combien ce choc tellurique avait, en contrariant à la fois les idées reçues et les invariants scientifiques, déterminé toute son existence ; pourquoi enfin sa morale, sa philosophie de la vie, sa disposition au bonheur, son perpétuel besoin d’aimer découlaient naturellement de ce drame dont il n’allait cesser de faire une promesse et une chance. ». Aussi contradictoire que cela puisse paraître, il voit dans la cécité une source de courage dans les épreuves physiques et morales, un surcroît d’aptitude au bonheur, à l’amour, au désir, un insatiable appétit de vivre – et voici, très justement, ce qu’écrit encore Jérôme Garcin : « Du camp de Buchenwald, un homme sans regard, si maigre qu’il semble flotter dans sa tenue rayée et puis s’y noyer, a pu écrire : « J’ai appris ici à aimer la vie. » Même si l’on en comprend le sens – il a appris ici à refuser de mourir, à se battre pour survivre –, cette phrase n’a pas d’équivalent dans toute la littérature concentrationnaire. Elle explose, comme une bombe, à la tête de tous les bourreaux. Elle les tue. ».
Jérôme Garcin, qui s’intéresse et nous intéresse assidûment à des écrivains que la postérité littéraire a injustement laissés de côté, mis en réserve en quelque sorte (Jean Prévost, maintenant mieux reconnu, Jean de la Ville de Mirmont, Jacques Chauviré, bien d’autres encore auxquels il fait une place de choix dans ses chroniques du Nouvel Observateur), et qui aime, par le jeu paradoxal des mots, des idées, des sentiments et des épisodes biographiques, dévoiler les secrets des existences et des créations, donne ici à la destinée de Jacques Lusseyran des couleurs, un relief, une profondeur que cet exceptionnel « voyant » eût aimé goûter de tous ses sens.
Jean-Pierre Longre
14:59 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, biographie, francophone, jacques lusseyran, jérôme garcin, gallimard, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
23/03/2016
Le secret d’Elena
 Liliana Lazar, Enfants du diable, Le Seuil, 2016
Liliana Lazar, Enfants du diable, Le Seuil, 2016
Dans les années 1970-1980, la politique nataliste de Ceauşescu faisait des ravages : avortements clandestins, accouchements sous x, abandons d’enfants qui venaient remplir les orphelinats sordides. Dans ce contexte, Elena Cosma, sage-femme à Bucarest, célibataire en mal d’enfant, décide d’adopter le bébé de Zelda, l’une de ses patientes, avec l’accord de celle-ci. Au bout de quelque temps, Zelda devenant trop pressante auprès de l’enfant, Elena décide de demander sa mutation et de partir avec lui pour un « voyage sans retour » à l’autre bout du pays, dans un village de Moldavie, Prigor.
À partir de là, les événements vont s’enchaîner rapidement. Le petit Damian, « enfant de Dieu », dont la beauté fragile ne rappelle en rien la physionomie robuste de sa « mère », et sur lequel courent diverses rumeurs, devient le souffre-douleur de ses camarades, tandis qu’Elena, la seule soignante du village, remplit le mieux possible sa mission d’infirmière pour une population dominée par la frayeur qu’inspire le « Despote » Miron Ivanov, maire du village. Désireuse d’étendre son activité, et aussi de se couler dans le moule politico-social de l’époque tout en gardant son secret familial, Elena propose aux autorités de créer un orphelinat à Prigor. L’établissement, installé dans une forêt à l’écart du village, est comme toutes les « maisons d’enfants » du pays un enfer pour ses pensionnaires, appelés (par allusion à leur « père » à tous, Ceauşescu) « enfants du diable »), qui survivent tant bien que mal (et parfois meurent) sous la férule des surveillants, mal nourris, privés de l’hygiène élémentaire et de tout ce qui fait les petits bonheurs habituels des enfants. Certains orphelins, issus du village, sont au cœur des mystères qui tournent autour d’Elena, de Damian, du maire Ivanov – et c’est ainsi que l’intrigue se faufile entre la réalité dramatique de cette période et les personnages lourds de leurs souffrances, de leurs silences, de leurs relations ambiguës, de leurs résignations et de leurs révoltes.
Le récit foisonnant, mené d’une plume alerte et vigoureuse, court sur une bonne dizaine d’années. À travers les histoires individuelles et au-delà des profondeurs mystérieuses que recèlent les personnages, les événements et les lieux (le village reculé, la forêt, l’étang – motifs que l’on trouvait déjà dans Terre des affranchis), c’est aussi l’histoire de la Roumanie qui se déroule : la dictature, les malheurs de la population, surtout des enfants, la catastrophe de Tchernobyl dont le retentissement est clairement sensible, la « révolution » de fin 1989, l’apparition des « humanitaires », qui traînent eux aussi leurs ambiguïtés… Roman à la fois historique, social, psychologique, noir, Enfants du diable mêle avec bonheur la réalité et l’imaginaire, la narration sèche et les mystères de la poésie. Belle manifestation d’une écriture combinant la maîtrise consommée de la langue française et la perpétuation d’un certain esprit roumain.
Jean-Pierre Longre
22:00 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, roumanie, liliana lazar, le seuil, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
12/03/2016
L’eau de la mémoire
 Valérie Zenatti, Jacob, Jacob, Éditions de l’Olivier, 2014, Points, 2016.
Valérie Zenatti, Jacob, Jacob, Éditions de l’Olivier, 2014, Points, 2016.
Prix du Livre Inter 2015
Une famille juive de Constantine, pauvre, besogneuse, où les hommes (le père, Haïm, le fils aîné, Abraham) font la loi, dure aux femmes et aux enfants fragiles ou rebelles. Dans la promiscuité forcée du petit appartement, rempli de bruits et de disputes, la personnalité de Jacob, le dernier né de Rachel, est celle d’un garçon à part : sensible, tendre, grand lecteur, rêveur, affectueux, il est en retour aimé de tous, particulièrement de sa vieille mère, qui va verser toutes ses larmes en le voyant partir à l’armée en 1944. Elle ne sait pas encore (lui non plus) qu’il va participer au débarquement de Provence, remonter jusqu’en Alsace, où il va perdre la vie.
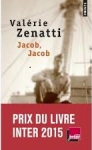 Volontiers solitaire, Jacob Melki n’est pas un misanthrope. De même qu’il avait pris sous son aile son neveu Gabriel, il s’attache au petit groupe qu’il forme avec ses camarades, et qui est représentatif de cette société algérienne où, malgré les disparités sociales, administratives et politiques entretenues par la France, juifs, musulmans, chrétiens cohabitaient en bonne entente. Ce petit groupe est uni jusque dans la souffrance et la mort par une solidarité mutuelle que symbolise la photo envoyée à la famille : « Avant de quitter la caserne d’Alger, Jacob s’est fait prendre en photo avec ses camarades devant une réplique du Normandie, et a posté le cliché à ses parents en griffonnant au dos Vive l’armée française ! De gauche à droite mes compagnons Ouabedssalam, Attali et Bonnin, vous me reconnaîtrez je pense, je n’ai pas tant changé. Je vous embrasse tous, chacun par son nom. Votre fils et frère Jacob. ».
Volontiers solitaire, Jacob Melki n’est pas un misanthrope. De même qu’il avait pris sous son aile son neveu Gabriel, il s’attache au petit groupe qu’il forme avec ses camarades, et qui est représentatif de cette société algérienne où, malgré les disparités sociales, administratives et politiques entretenues par la France, juifs, musulmans, chrétiens cohabitaient en bonne entente. Ce petit groupe est uni jusque dans la souffrance et la mort par une solidarité mutuelle que symbolise la photo envoyée à la famille : « Avant de quitter la caserne d’Alger, Jacob s’est fait prendre en photo avec ses camarades devant une réplique du Normandie, et a posté le cliché à ses parents en griffonnant au dos Vive l’armée française ! De gauche à droite mes compagnons Ouabedssalam, Attali et Bonnin, vous me reconnaîtrez je pense, je n’ai pas tant changé. Je vous embrasse tous, chacun par son nom. Votre fils et frère Jacob. ».
Le récit de Valérie Zenatti ne se termine pas avec la mort de Jacob, ni même avec le chagrin récurrent de Rachel, que la moindre image ramène à celle de son fils chéri. D’une guerre à l’autre, de 1944 à 1961, il rappelle les épreuves subies par l’Algérie et ses habitants, le douloureux départ de la famille de Rachel et Haïm pour la métropole. Mais ce n’est pas un roman historique. Le lien personnel de l’auteure avec Jacob et sa famille, révélé dans les dernières lignes, est en quelque sorte annoncé d’une manière voilée, sous-jacente, dans l’intimité narrative installée par le style. Comme si la sensibilité de Jacob avait déteint sur l’écriture, la force du récit est contenue dans des phrases sinueuses, dont la structure épouse celle des émotions humaines, ces émotions qui forment la trame véritable de l’histoire. Et la mémoire se révèle dans le tracé fluctuant de ces phrases, fluctuant comme l’eau qui passe sous le grand pont suspendu de Constantine qu’on ne franchit pas sans une « peur délicieuse », fluctuant comme cette Méditerranée qu’il faut traverser pour accomplir son destin.
Jean-Pierre Longre
17:54 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, valérie zenatti, Éditions de l’olivier, points, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
04/03/2016
Londres-Varatec aller-retour
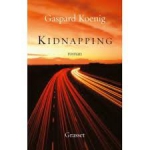 Gaspard Koenig, Kidnapping, Grasset, 2016
Gaspard Koenig, Kidnapping, Grasset, 2016
Ruxandra, que ses employeurs appellent Roxy, a quitté la Roumanie, espérant y revenir un jour suffisamment riche pour tenir une pharmacie avec son fiancé Mircea. Son emploi de « nanny » dans une famille britannique lui fait découvrir un monde radicalement différent de celui qu’elle a laissé. David, « senior banker » rivé à son BlackBerry et à ses perspectives de carrière, Ivana, qui tente d’oublier et de faire oublier ses origines croates en se coulant dans le moule du snobisme londonien, et le petit George, élevé selon des principes bien arrêtés, auquel Roxy se prend d’une affection de plus en plus maternelle, tout en restant en étroite relation avec une de ses tantes demeurant dans sa région natale.
Or la banque dans laquelle David travaille est impliquée dans le projet européen du « Corridor IX », autoroute qui relierait la Grèce à la Finlande en passant par la Bulgarie, la Roumanie, la Moldavie, l’Ukraine et la Russie. « De la mer Égée à la Baltique ! », s’enthousiasme le commissaire européen aux transports. David, désireux de monter en grade, se propose pour prendre en charge le tronçon roumain de cet axe, dont sa banque aura la responsabilité – et la Roumanie va ainsi devenir l’objet de ses préoccupations professionnelles. Pas plus, au départ. Puis, à mesure que le projet se précise, greffant sur l’axe principal des voies rapides vers les fameux monastères de Bucovine et de Neamt – ce qui attise la révolte dans les campagnes, les villageois risquant de pâtir des travaux à venir –, il approfondit sa connaissance du pays. Un voyage pittoresque et relativement mouvementé jusqu’au au monastère de Varatec, cœur de la contestation, et que Ruxandra connaît bien, semble lui ouvrir les yeux sur la réalité du terrain et sur les nécessaires négociations à mener.
 Visiblement, Gaspard Koenig maîtrise son sujet et l’art du roman. La vie londonienne avec ses rites et ses clivages sociaux, la Roumanie dans sa diversité, Bucarest, son animation et ses excès, les campagnes profondes, les monastères et leurs traditions (certains clichés tenaces aussi), les ambitions souvent restées lettre morte des instances européennes, les péripéties que les confrontations entre ces univers entraînent, les traits satiriques auxquels peu échappent : tout est réuni pour procurer une lecture à la fois rebondissante et documentée, qui n’exclut pas la réflexion sur la marche économique du monde et les dissensions qu’elle induit au sein de l’Europe. Un simple échange entre David le banquier de la City et Veronica la bibliothécaire du monastère de Varatec résume parfaitement l’incompréhension réciproque : « Avec l’autoroute, la croissance du département de Neamt devrait attendre les 5% par an. – La croissance de quoi, mon fils ? ». Kidnappeur, kidnappé, les rôles ne sont pas définitivement distribués…
Visiblement, Gaspard Koenig maîtrise son sujet et l’art du roman. La vie londonienne avec ses rites et ses clivages sociaux, la Roumanie dans sa diversité, Bucarest, son animation et ses excès, les campagnes profondes, les monastères et leurs traditions (certains clichés tenaces aussi), les ambitions souvent restées lettre morte des instances européennes, les péripéties que les confrontations entre ces univers entraînent, les traits satiriques auxquels peu échappent : tout est réuni pour procurer une lecture à la fois rebondissante et documentée, qui n’exclut pas la réflexion sur la marche économique du monde et les dissensions qu’elle induit au sein de l’Europe. Un simple échange entre David le banquier de la City et Veronica la bibliothécaire du monastère de Varatec résume parfaitement l’incompréhension réciproque : « Avec l’autoroute, la croissance du département de Neamt devrait attendre les 5% par an. – La croissance de quoi, mon fils ? ». Kidnappeur, kidnappé, les rôles ne sont pas définitivement distribués…
Jean-Pierre Longre
17:57 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, gaspard koenig, grasset, jean-pierre longre, roumanie | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
26/02/2016
L’Histoire et le Roman
 Milena Agus, Luciana Castellina, Prends garde, traduit de l’italien par Marianne Faurobert et Marguerite Pozzoli, Liana Levi, 2015, Liana Levi Piccolo, mars 2016.
Milena Agus, Luciana Castellina, Prends garde, traduit de l’italien par Marianne Faurobert et Marguerite Pozzoli, Liana Levi, 2015, Liana Levi Piccolo, mars 2016.
Prix Méditerranée étranger 2015
L’histoire des Pouilles entre 1943 et 1946 est tourmentée, complexe, violente. Histoire politique (le sort de l’Italie après la chute de Mussolini et le débarquement des alliés), histoire sociale (la misère des ouvriers agricoles et leurs révoltes contre les propriétaires terriens). Le mérite de Luciana Castellina, écrivaine et journaliste engagée à gauche, est de retracer d’une manière vivante, détaillée, claire, ces épisodes d’un passé trop vite oublié. Cela à partir d’un événement survenu le 7 mars 1946 sur la place principale de la ville d’Andria, entre Foggia et Bari, où des milliers de personnes s’étaient rassemblées pour écouter le discours du fameux syndicaliste Giuseppe Di Vittorio : un ou deux coups de feu furent tirés depuis la riche demeure des sœurs Porro, issues d’une grande famille locale. Les pages qui suivent décrivent donc le contexte historique, local et national, situant les faits.
 Retournons le livre. Même illustration, mais cette fois le titre Prends garde est précédé d’un autre nom : Milena Agus. La romancière sarde, devenue célèbre avec son Mal de pierres (2007), est partie du même épisode, les coups de feu tirés sur la place d’Andria. Symétriquement à la relation fidèle de la réalité historique, la fiction romanesque nous fait pénétrer dans la demeure toujours fermée des sœurs Porro, vieilles héritières d’une tradition composée de piété, de charité, de gestes routiniers, de non-dits, de conservatisme. Celle qui nous y emmène et qui nous les fait connaître de l’intérieur est du même monde qu’elles, mais plus ouverte, révoltée, extravagante (du moins aux yeux de ses semblables) : « Gracieuses, raides et efflanquées, elles l’accueillaient, elle, pataude et replète, qui, assise sur le sofa avec les jambes trop écartées, faisait la révolution. Elles l’écoutaient, prenaient peur, et riaient en se cachant la bouche. ».
Retournons le livre. Même illustration, mais cette fois le titre Prends garde est précédé d’un autre nom : Milena Agus. La romancière sarde, devenue célèbre avec son Mal de pierres (2007), est partie du même épisode, les coups de feu tirés sur la place d’Andria. Symétriquement à la relation fidèle de la réalité historique, la fiction romanesque nous fait pénétrer dans la demeure toujours fermée des sœurs Porro, vieilles héritières d’une tradition composée de piété, de charité, de gestes routiniers, de non-dits, de conservatisme. Celle qui nous y emmène et qui nous les fait connaître de l’intérieur est du même monde qu’elles, mais plus ouverte, révoltée, extravagante (du moins aux yeux de ses semblables) : « Gracieuses, raides et efflanquées, elles l’accueillaient, elle, pataude et replète, qui, assise sur le sofa avec les jambes trop écartées, faisait la révolution. Elles l’écoutaient, prenaient peur, et riaient en se cachant la bouche. ».
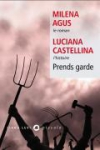 Les deux points de vue, historique et romanesque, prolétarien et possédant, renvoient l’un à l’autre, et font saisir la profondeur des choses et des gens. D’un côté le drame collectif de toute une région, voire d’un pays ; de l’autre « la tragédie des sœurs Porro », d’une famille riche en fin de parcours. D’un côté les foules et leurs luttes pour une société plus juste, de l’autre les individus et leur psychologie, leurs sentiments plus ou moins cachés, leurs combats intérieurs. L’imaginaire et le réel, loin de s’opposer, se complètent parfaitement pour faire saisir, en tout cas approcher la vérité humaine dans toute sa complexité.
Les deux points de vue, historique et romanesque, prolétarien et possédant, renvoient l’un à l’autre, et font saisir la profondeur des choses et des gens. D’un côté le drame collectif de toute une région, voire d’un pays ; de l’autre « la tragédie des sœurs Porro », d’une famille riche en fin de parcours. D’un côté les foules et leurs luttes pour une société plus juste, de l’autre les individus et leur psychologie, leurs sentiments plus ou moins cachés, leurs combats intérieurs. L’imaginaire et le réel, loin de s’opposer, se complètent parfaitement pour faire saisir, en tout cas approcher la vérité humaine dans toute sa complexité.
Jean-Pierre Longre
12:04 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, histoire, italie, milena agus, luciana castellina, marianne faurobert et marguerite pozzoli, liana levi, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
22/02/2016
Rêves d’Italie
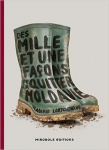 Vladimir Lortchenkov, Des mille et une façons de quitter la Moldavie, traduit du russe par Raphaëlle Pache, Mirobole éditions, 2014, Pocket 2015
Vladimir Lortchenkov, Des mille et une façons de quitter la Moldavie, traduit du russe par Raphaëlle Pache, Mirobole éditions, 2014, Pocket 2015
Les habitants de Larga, pauvre village de la pauvre Moldavie, ont une obsession : s’exiler vers l’Italie, où chacun trouvera, c’est sûr, un travail – n’importe lequel, car il sera dans tous les cas plus lucratif que l’oisiveté forcée ! S’y exiler, et y rester. Comme le dit un vieux paysan : « Ceux qui partent pour notre Italie en reviennent jamais ! Les gens qui ont atterri là-bas s’en plaignent pas. En fait, c’est comme s’ils étaient morts, parce que l’Italie, au final, c’est le paradis. Et à celui qui y accède, point de retour en arrière. ».
Ce « paradis », on cherche à y accéder par tous les moyens et certains sont spécialistes en la matière. Séraphim Botezatu, notamment, n’hésite pas à entraîner ses camarades dans des expéditions aussi ambitieuses que farfelues : s’envoler sur un tracteur, partir dans un sous-marin fabriqué avec le même tracteur… Inutile de dire que chaque essai se solde par un échec retentissant, et qu’on se retrouve non à Rome mais à Chişinau, non sur les côtes italiennes mais sur les rives du Dniestr… Le pope Païssïï lui-même se laisse gagner par la contagion et organise deux « croisades », entraînant des milliers, voire des dizaines de milliers d’ouailles dans une procession guerrière qui, évidemment, ne pourra franchir les frontières. Le président du pays en personne, par la voie des airs et en usant de ruses inouïes, parviendra-t-il à ses fins ?
 Des mille et une façons de quitter la Moldavie est un livre drôle et tragique, d’un humour farce et noir, qui met à nu, par la caricature et le burlesque, le désir désespéré d’un avenir meilleur, d’un autre monde. D’un humour satirique aussi, qui n’épargne personne : ni les « Moldaves », petits ou grands, épinglés par l’un des leurs, ni les peuples voisins, ni l’Union Européenne – ni le genre humain en général. On rit beaucoup mais parfois jaune à la lecture de ces aventures cruelles, on compatit, et on en arrive à sympathiser avec ces personnages en perpétuelle quête d’une autre vie. Une autre vie en Italie ? La vérité, elle est sans doute encore détenue par le vieux Tudor (dont les villageois n’auront pourtant aucune pitié) : « À partir d’aujourd’hui, je deviens le pope du village. Et je déclare que le culte de l’Italie est une hérésie ! Parce que la véritable Italie se trouve en chacun de nous ! Et à partir d’aujourd’hui, telle doit être notre unique croyance. ».
Des mille et une façons de quitter la Moldavie est un livre drôle et tragique, d’un humour farce et noir, qui met à nu, par la caricature et le burlesque, le désir désespéré d’un avenir meilleur, d’un autre monde. D’un humour satirique aussi, qui n’épargne personne : ni les « Moldaves », petits ou grands, épinglés par l’un des leurs, ni les peuples voisins, ni l’Union Européenne – ni le genre humain en général. On rit beaucoup mais parfois jaune à la lecture de ces aventures cruelles, on compatit, et on en arrive à sympathiser avec ces personnages en perpétuelle quête d’une autre vie. Une autre vie en Italie ? La vérité, elle est sans doute encore détenue par le vieux Tudor (dont les villageois n’auront pourtant aucune pitié) : « À partir d’aujourd’hui, je deviens le pope du village. Et je déclare que le culte de l’Italie est une hérésie ! Parce que la véritable Italie se trouve en chacun de nous ! Et à partir d’aujourd’hui, telle doit être notre unique croyance. ».
Jean-Pierre Longre
09:33 Publié dans Humour, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, humour, russe, moldavie, vladimir lortchenkov, raphaëlle pache, mirobole éditions, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
31/01/2016
Roman d’une écriture
 Loïc Folleat , Des débris, des éclats, Carnet d’art, 2015
Loïc Folleat , Des débris, des éclats, Carnet d’art, 2015
Pourquoi écrire ? Éternelle question, souvent posée à tort et à travers, et qui a donné lieu à tous les clichés, à tous les truismes, à tous les refus. Dans son bref « roman », Loïc Folleat tente d’y répondre avant qu’on la lui pose. Mais ce n’est pas tout, et ce n’est pas si simple. Des débris, des éclats (deux parties précisément identifiées, géométriquement réparties) est un livre riche d’une expérience qui, pour encore brève qu’elle soit, est celle d’une arrivée à maturité, avec tous les paradoxes que cela implique : expérience du réel et de l’imaginaire, de la veille et du rêve, expérience du désespoir et de l’espoir, de la souffrance et du plaisir, de la solitude et de l’amour, du silence et de la parole, du vide et de la plénitude, de l’aliénation et de la liberté, des risques et des bonheurs de l’écriture.
En proses compactes ou aérées, en vers libres parfois, en images poétiques, l'auteur met à contribution toutes les ressources de la langue – ne rechignant pas à en jouer (à « caresser le texte »), à en extirper aussi l'extrême violence (voir la terrible danse macabre de la littérature qui s’achève sur une authentique profession de foi littéraire : « Moi, j’écris depuis ma vie.[…] J’écris tout tout de suite, le plus tôt possible ».).
Des « débris » aux « éclats », des morceaux de vie à l’« écriture qui délivre », le récit suit un cheminement tortueux, à la fois tourmenté et maîtrisé (« Je muselle mes émotions, j’accède aux mots »). Il y a là un peu de Rimbaud, « l’enfant infini », un peu de la « table rase » des révolutionnaires, un peu de Leiris (« Métier de l’écrivain : s’exposer au danger, puis le faire mijoter dans le secret de son intérieur »), un peu de Cioran, pour les aphorismes paradoxaux… Il y a surtout l’itinéraire personnel et obstiné d’un jeune écrivain qui s’invente, s’explore, « crée [s]es fictions », et qui donne à lire un texte dense et fort, brisé mais éclatant de promesses.
Jean-Pierre Longre
17:08 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, poésie, essai, loïc folleat, carnet d’art, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
21/01/2016
Troubles en Transylvanie
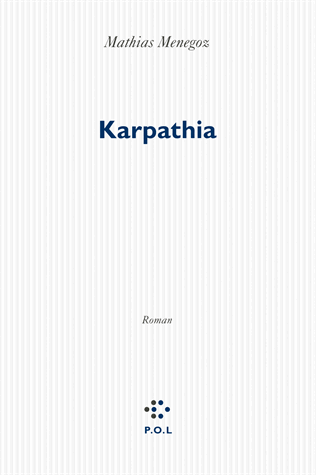 Mathias Menegoz, Karpathia, P.O.L., 2014, Folio, janvier 2016
Mathias Menegoz, Karpathia, P.O.L., 2014, Folio, janvier 2016
Prix Interallié 2014
Pour un jeune noble hongrois vivant à Vienne dans les années 1830 (comme pour beaucoup de nos contemporains), le nom même de Transylvanie recèle sa part de légendes, d’exotisme et de mystère. C’est pourtant là-bas, aux confins de l’empire austro-hongrois, que le comte Alexander Korvanyi, tout juste réchappé d’un duel meurtrier et fraîchement marié avec une jeune fille de bonne famille autrichienne, Charlotte (dite Cara) von Amprecht, décide d’aller s’installer avec son épouse, afin de reprendre en main le domaine familial, dont l’histoire tourmentée est liée à celle du pays entier.
Parvenu sur place, installé dans son château, le couple découvre une contrée aux aspects à la fois sauvages et inattendus, vastes pâturages, lac paisible, sombres forêts, villages modestes ou miséreux… Dans cette vallée de la Korvanya et sur les terres voisines se côtoient sans se mélanger les différentes communautés qui peuplent la Transylvanie, et dont la présence plus antagoniste qu’harmonieuse résulte des événements des siècles passés. Magyars (Hongrois), Széklers (Sicules), Saxons (Allemands), Valaques (Roumains), Tsiganes – chacun occupe sa place, dans son rôle social (seigneurs, militaires, domestiques, serfs, ouvriers itinérants, bergers, forestiers, contrebandiers...). Le fougueux Alexander décide de mettre sans ménagement tout ce monde au pas de ses décisions, se disant que les révoltes passées doivent être définitivement oubliées. Mais quelques événements étranges (des disparitions d’enfants tsiganes ou valaques, le viol d’une jeune hongroise, des attaques de loups – ou d’hommes ? – contre des troupeaux), s’ajoutant à l’intransigeance du jeune comte et à l’animosité d’une bande de contrebandiers, mettent le feu aux poudres, et ce qui était prévu comme un rassemblement de chasseurs tourne à l’explosion de violence et au massacre.
 Karpathia raconte des aventures mouvementées, laissant une part non négligeable à l’imaginaire, mais c’est aussi un roman historique, social et psychologique. Les espaces temporel et géographique y sont précisément délimités ; les noms hongrois des localités (mis à part celui de la fictive Korvanya), la cohabitation inamicale des communautés nationales et linguistiques, le pittoresque des paysages – tout correspond à une réalité vérifiable, fruit d’une sérieuse documentation. Les personnages, bien campés dans leurs individualités parfois complexes, dans leurs réactions contrastées, dans leur orgueil sans concessions, dans leurs passions, leurs ambitions ou leurs révoltes, avec leurs forces et leurs faiblesses, sont plus que des types humains : des êtres en proie à leurs doutes et à leurs convictions, à leurs superstitions et à leurs calculs, à leur sensibilité et à leur violence. La prose de Mathias Menegoz, à la fois élaborée et enlevée, classique et audacieuse, combinant le souci du détail et la rapidité de la narration, l’arrêt sur image et la vivacité de l’action, est celle d’un vrai romancier – traditionnel ? Sans doute, mais en l’occurrence ce n’est pas un défaut, au contraire. En tout cas, pour le lecteur, un plaisir auquel le tourment prend une belle part.
Karpathia raconte des aventures mouvementées, laissant une part non négligeable à l’imaginaire, mais c’est aussi un roman historique, social et psychologique. Les espaces temporel et géographique y sont précisément délimités ; les noms hongrois des localités (mis à part celui de la fictive Korvanya), la cohabitation inamicale des communautés nationales et linguistiques, le pittoresque des paysages – tout correspond à une réalité vérifiable, fruit d’une sérieuse documentation. Les personnages, bien campés dans leurs individualités parfois complexes, dans leurs réactions contrastées, dans leur orgueil sans concessions, dans leurs passions, leurs ambitions ou leurs révoltes, avec leurs forces et leurs faiblesses, sont plus que des types humains : des êtres en proie à leurs doutes et à leurs convictions, à leurs superstitions et à leurs calculs, à leur sensibilité et à leur violence. La prose de Mathias Menegoz, à la fois élaborée et enlevée, classique et audacieuse, combinant le souci du détail et la rapidité de la narration, l’arrêt sur image et la vivacité de l’action, est celle d’un vrai romancier – traditionnel ? Sans doute, mais en l’occurrence ce n’est pas un défaut, au contraire. En tout cas, pour le lecteur, un plaisir auquel le tourment prend une belle part.
Jean-Pierre Longre
18:50 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, roumanie, mathias menegoz, p.o.l., jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
14/01/2016
Des lettres pour comprendre
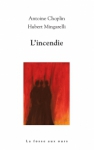 Antoine Choplin, Hubert Mingarelli, L’incendie, La fosse aux ours, 2015
Antoine Choplin, Hubert Mingarelli, L’incendie, La fosse aux ours, 2015
Après la guerre qui a ensanglanté l’ex-Yougoslavie, l’un est resté à Belgrade, l’autre s’est exilé en Argentine. Celui-ci est revenu quelque temps dans son pays pour enterrer son père, et ils se sont revus à cette occasion, ont évoqué des souvenirs, dont celui de Branimir, le troisième compagnon qui, va-t-on apprendre, est mort.
Mais leur conversation n’est pas allée très loin. Jovan, de Belgrade, et Pavle, de Puerto Madryn, finissent par s’écrire, et ce sont leurs lettres qui reconstruisent le passé, celui de la guerre contre la Croatie, et plus particulièrement celui d’un épisode dramatique dont ils ont été les acteurs. Dramatique, noir, maudit – et c’est cette malédiction qui fait obstacle à la parole et à la mémoire. C’est donc par l’écrit, un écrit dans lequel le non-dit va peu à peu laisser transparaître les aveux, dans lequel la limpidité va éclore dans l’obscurité, dans lequel le pathétique va prendre l’ascendant sur le tragique, que la vérité va se faire.
Durant le conflit, les trois jeunes hommes se sont vu confier par leur chef la mission d’aller fouiller une maison – qui est finalement devenue le lieu du drame que Jovan et Pavle ont en vain tenté d’oublier, tant la noirceur des hommes peut être aveuglante. Cependant de leurs aveux épistolaires vont naître non seulement la honteuse vérité, mais aussi une lueur d’espoir en l’âme humaine, dans sa complexité. Et de cette complexité, Antoine Choplin et Hubert Mingarelli font un récit dont la progression à la fois simple et minutieusement dosée, lettre par lettre, structure l’attente du lecteur, qui petit à petit apprend à connaître le passé des deux amis. Dans une prose simple et harmonieuse, rythmée par les scrupules, les réticences et les questions qui n’en sont pas vraiment (l’absence de points d’interrogation est significative), une prose collant aux préoccupations et aux sentiments des protagonistes, L’incendie est un récit qui, exempté des grands effets de style et de la rhétorique superflue que l’on trouve parfois dans les ouvrages relatifs à ce genre d'événement, suscite l’émotion et donne à méditer sur les conséquences bouleversantes de la guerre.
Jean-Pierre Longre
18:40 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, récit, épistolaire, francophone, antoine choplin, hubert mingarelli, la fosse aux ours, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
04/01/2016
Reddition

Éric Reinhardt, romancier qui n’hésite pas à se transformer en être de fiction dans son propre récit (tout en restant l’auteur – statut à la fois complexe et authentique), reçoit une belle lettre, puis des messages, et enfin, au cours de deux rencontres à la terrasse du Nemours, près du Palais-Royal, les confidences de Bénédicte Ombredanne, professeur de Lettres et fervente lectrice. C’est ainsi que l’on découvre une jeune femme qui, possédant les atouts ordinaires de l’émancipation individuelle (un métier intéressant, un physique agréable, un esprit ouvert, une culture supérieure à la moyenne), se laisse peu à peu dévorer par la perversion d’un mari dont on se demande, épisodiquement, pourquoi elle ne l’abandonne pas à ses complexes et à son narcissisme.
Certes, une journée de sa vie, parenthèse d’enchantement, lui a laissé entrevoir le bonheur éclatant de l’amour, mais a aussi précipité le harcèlement quasiment incompréhensible auquel elle est soumise, et l’a plongée dans la tragédie quotidienne d’une vie aux côtés d'un époux odieux et d’enfants indifférents, voire hostiles. Quelques jours passés en clinique psychiatrique lui procurent un répit trop bref, que la Faculté et son mari, comme ligués contre elle, refusent de prolonger malgré son désir ardent et sa peur du retour au domicile. L’amour et les forêts pourrait, ainsi, être un roman psychologique donnant matière à une réflexion sociale sur le harcèlement et sur les violences conjugales.
 Il est plus que cela. Si l’histoire passe par les confidences de Bénédicte Ombredanne retranscrites par le romancier (qui met sans doute une part de lui-même dans son personnage féminin), il y a aussi le point de vue de la sœur jumelle de la jeune femme, qui se dévoile sur le tard, dans une sorte de bifurcation narrative. Car on découvre, par la bouche de cette sœur aimante, des épisodes dont Bénédicte n’avait pas parlé à l’auteur – de même qu’elle en avait caché d’autres à sa sœur. S’est bâti dans son esprit et dans sa parole comme un cloisonnement, résultant sans doute du décalage, du fossé même entre ce qu’elle attendait de la vie et ce qu’elle y trouvait. « Elle se battait avec quelque chose de lointain et elle n’a pas triomphé. Le scepticisme et le désenchantement l’ont emporté », dit la sœur qui évoque un mot que Bénédicte adorait, un mot de chanson, « surrender » - « reddition ». C’est cela. Personnage de tragédie (plus que de roman psychologique ou psychanalytique), Bénédicte Ombredanne, comme d’autres avant elle (dans la littérature et dans la vie), mais avec ses propres raisons conscientes ou non, avouées ou non, et selon un cheminement tout en virages et en ressassements (auquel semble coller le style d’ Éric Reinhardt), s’est rendue : à son mari, qui « avait sur elle, inexplicablement, une emprise absolue », et surtout à un destin pathétique qui, si l’on n’a pas connu les affres de la dépendance irrépressible, peut paraître absurde.
Il est plus que cela. Si l’histoire passe par les confidences de Bénédicte Ombredanne retranscrites par le romancier (qui met sans doute une part de lui-même dans son personnage féminin), il y a aussi le point de vue de la sœur jumelle de la jeune femme, qui se dévoile sur le tard, dans une sorte de bifurcation narrative. Car on découvre, par la bouche de cette sœur aimante, des épisodes dont Bénédicte n’avait pas parlé à l’auteur – de même qu’elle en avait caché d’autres à sa sœur. S’est bâti dans son esprit et dans sa parole comme un cloisonnement, résultant sans doute du décalage, du fossé même entre ce qu’elle attendait de la vie et ce qu’elle y trouvait. « Elle se battait avec quelque chose de lointain et elle n’a pas triomphé. Le scepticisme et le désenchantement l’ont emporté », dit la sœur qui évoque un mot que Bénédicte adorait, un mot de chanson, « surrender » - « reddition ». C’est cela. Personnage de tragédie (plus que de roman psychologique ou psychanalytique), Bénédicte Ombredanne, comme d’autres avant elle (dans la littérature et dans la vie), mais avec ses propres raisons conscientes ou non, avouées ou non, et selon un cheminement tout en virages et en ressassements (auquel semble coller le style d’ Éric Reinhardt), s’est rendue : à son mari, qui « avait sur elle, inexplicablement, une emprise absolue », et surtout à un destin pathétique qui, si l’on n’a pas connu les affres de la dépendance irrépressible, peut paraître absurde.
Jean-Pierre Longre
11:53 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, Éric reinhardt, gallimard, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
02/01/2016
Roman sans paroles
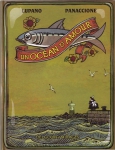 Wilfrid Lupano, Grégory Panaccione, Un océan d’amour, Delcourt/Mirages, 2014
Wilfrid Lupano, Grégory Panaccione, Un océan d’amour, Delcourt/Mirages, 2014
Prix BD Fnac 2015
C’est l’histoire d’un petit pêcheur breton qui, parti de grand matin comme chaque jour, subit un accident peu commun : son rafiot se fait prendre dans les filets d’un énorme chalutier. En vrai capitaine courageux, il laisse son matelot se sauver sur le canot de secours, tandis que lui-même reste sur sa coque de noix dangereusement suspendue au flanc du navire. Pendant ce temps, son épouse, rongée d’inquiétude mais forte femme, ne reste pas à se morfondre : elle se met à enquêter sur ce qui a pu arriver à son petit mari chéri. S’ensuivent toutes sortes d’aventures, pour l’un comme pour l’autre, entre leur point de départ et Cuba, avant un happy end bien mérité pour ce couple à la fois simple et hors normes, pour qui l’océan est bien un vaste champ d’amour.
L’originalité de cet album à la fois touchant, drôle, haletant, tourmenté, réside bien sûr dans les aventures inattendues de nos deux héros, mais aussi dans sa facture : tout n’est raconté qu’en images, comme dans un film muet. Aucun phylactère, aucun texte narratif ou descriptif, pas un mot. Et l’on comprend tout – du moins tout ce qu’il y a à comprendre, car il faut bien un peu de mystère, quand même, dans la vie présente et passée, dans la réalité et dans le rêve –. On est pris par le graphisme, l’expressivité des visages, les gestes des corps, les mouvements de la nature, des êtres, des objets… On suit, rempli d’émotion, le fil des événements où il est question non seulement de pêche et de tempête, de séparation et d’amour, mais aussi de sardines (fraîches ou en boîte), de mouettes, de pirates, de croisière, de cuisine, de danse, de pétrole, de Fidel Castro en personne, d’avion… Tout est là pour tenir le lecteur en haleine, tout, sauf les paroles, dont on se passe bien.
Jean-Pierre Longre
16:38 Publié dans Mots et images | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : bande dessinée, wilfrid lupano, grégory panaccione, éditions delcourt, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
29/12/2015
Impasses de la littérature ?
 Maxime Decout, En toute mauvaise foi. Sur un paradoxe littéraire, Les éditions de Minuit, 2015
Maxime Decout, En toute mauvaise foi. Sur un paradoxe littéraire, Les éditions de Minuit, 2015
« La mauvaise foi est la chose du monde la mieux partagée. Elle se range de prime abord à côté des mensonges, haines, hontes, colères ou autres sentiments violents qui constituent la matière même de l’humain. ». Autrement dit, elle est « inscrite dans la structure même de l’être. ». D’emblée le lecteur est mis en condition, prévenu : les cinq chapitres du livre vont montrer que la littérature, l’une des formes esthétiques les plus fréquentées, l’un des modes d’expression les plus répandus, est une incessante manifestation de mauvaise foi.
Il ne faut pas, comme on le fait souvent, confondre mauvaise foi et mensonge. « La littérature ment », certes – la fiction et la poésie le font naturellement –, mais il s’agit ici de développer l’idée que quelles que soient les postures de ses acteurs, y compris celles des autobiographes, voire des « sincéromanes exaltés », le discours littéraire respire la mauvaise foi dans son fonctionnement, même lorsque celle-ci est reconnue, avouée. Il suffit d’« ouvrir le ventre du texte, [d’] ausculter sa circulation et sa respiration » pour le constater.
Maxime Decout ne s’en prive pas. Son essai n’a rien d’un pensum théorique : tous les constats, toute l'argumentation s’appuient sur les œuvres d’auteurs choisis, dont certains ont leur place naturellement désignée par le sujet (Montaigne, Rousseau, Stendhal, Dostoïevski, Leiris, Sartre, Blanchot, Sarraute, Perec…), mais dont d’autres sont sollicités d’une manière moins attendue, cependant pleinement convaincante (Madame de Lafayette, Molière, Zola, Mauriac, Queneau, la liste complète serait trop longue), et le recours au roman policier n’est pas négligé. Cela va, par exemple, jusqu’à une « querelle de la mauvaise foi » qui se joue en trois actes entre certains pratiquants et/ou théoriciens. Et en guise d’épilogue, une « petite histoire de (la) mauvaise foi » (remarquer la subtile et plaisante équivoque de la présence ou de l’absence d’article), qui nous mène du XVIIème siècle à nos jours, comme un vrai manuel littéraire.
Un essai ? Un traité ? Une histoire littéraire ? Oui à toutes les questions, mais aussi un dialogue avec le lecteur, dans lequel l’auteur n’hésite pas à se mettre en scène, jouant avec les références, les vrais-faux aveux (« Prenez donc garde, lecteur, de ne pas vous fier au texte que vous avez entre les mains »), les vraies-fausses questions (« Est-il possible d’envisager un personnage sans mauvaise foi ? Vous avez envie de répondre oui. Moi aussi ». Espoir ruiné dans les lignes qui suivent, bien sûr…). Et si les impasses sont implacablement constatées (par l’auteur, par le lecteur), l’étude du « paradoxe littéraire » ici déployée est une fine analyse, en général, de ce qu’est la littérature et, en particulier, de la « fécondité sans pareille qui innerve une multitude de trajets d’écriture. ».
Jean-Pierre Longre
17:40 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, francophone, maxime decout, les éditions de minuit, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
23/12/2015
Vibrants instantanés
 Catherine Leblanc, Il n’est pas d’étrangers, L’Amourier, 2015
Catherine Leblanc, Il n’est pas d’étrangers, L’Amourier, 2015
« Les mots écrits ne sont pas les mêmes que les mots parlés. Ce sont des mots gardés, des mots goûtés, des mots sauvés, des mots choisis un à un pour former une flèche touchant au cœur. Les mots écrits préservent le silence. ». Le dernier texte, en guise de postface à ce délicat petit livre, est en quelque sorte une justification de tout ce qui précède (au cas où elle soit nécessaire), une reprise de son essence même ; car ici les mots écrits « touchent des gens qu’on ne connaît pas, qu’on ne voit jamais, des gens qui sont brûlés ou blessés, des gens qu’il ne faut pas approcher en criant. ».
En quatre sections (« Passants », « Parole première », « Pages volantes », « N’être »), Catherine Leblanc présente tout en finesse, dans de courtes pages empathiques, des êtres qu’elle a croisés dans la rue ou ailleurs, ou qu’elle a connus plus personnellement lors de consultations psychologiques ; elle se présente aussi elle-même à la première personne (« J,e, deux petites lettres pour échapper aux crocs »), avec ses souvenirs et ses impressions. Ceux dont elle parle sont des êtres souvent fragiles, ou sous influence : une petite vieille qui traverse la rue, un garçon contrôlé au faciès par la police, un enfant trop sage pour ne pas être violent au fond de lui, un cheval à la fois puissant et docile, un adolescent perturbé…
Ce ne sont pas des portraits en forme, ni des récits de vie, ni des nouvelles, mais un peu tout cela. « Proses brèves », dit le sous-titre, auquel il faudrait ajouter : poèmes. Une poésie composée d’instantanés qui, loin de figer les existences, les traduit en images vibrantes, comme des « bulles irisées » qui « s’éparpillent » et « s’évaporent », cependant que « l’image reste, indissoluble, indestructible. ».
Jean-Pierre Longre
09:57 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : portraits, poésie, francophone, catherine leblanc, l’amourier, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
07/12/2015
« La bonne éducation »
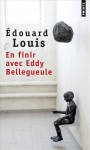 Édouard Louis, En finir avec Eddy Bellegueule, Le Seuil, 2014, Points, 2015
Édouard Louis, En finir avec Eddy Bellegueule, Le Seuil, 2014, Points, 2015
Chaque classe sociale a ses normes, ses règles, ses exigences, ses frontières hors desquelles on est considéré comme un paria. Pour échapper à l’ostracisme, seule la fuite semble être la solution. Fuir les autres, fuir la famille, fuir les insultes, les coups et les humiliations, fuir jusqu’à son nom, tel est l’argument du premier roman d’Édouard Louis, dont le succès lors de sa parution aux éditions du Seuil lui vaut maintenant une édition en poche (Points).
Un roman qui superpose et mêle plusieurs genres en une composition binaire : Livre 1, « Picardie (fin des années 1990 – début des années 2000) » ; Livre 2, « L’échec et la fuite ». Plusieurs genres, donc : roman social (l’auteur a lu et étudié Pierre Bourdieu), qui campe et analyse de l’intérieur le prolétariat de la fin du XXème et du début du XXIème siècle, à coups de descriptions sans concessions (mais sans jugement moral) et de citations orales – ce qui, stylistiquement parlant, a le mérite de mêler les registres de langue et de faire ressortir la crudité verbale que l’auteur a su mettre à distance. Le roman autobiographique, qui narre dans un mélange subtil d’objectivité et d’hypersensibilité le douloureux décalage que le jeune Eddy ressent par rapport à sa famille, à ses copains, et qu’il tente désespérément d’effacer. Le roman initiatique d’un garçon qui se sent rapidement différent des autres, féminin, dans un milieu où la virilité ostensible est la marque obligée du monde des hommes, un garçon qui voudrait ne pas être ce qu’il est, qui s’essaie à l’amour des filles mais ne peut échapper à l’opprobre de plus en plus ricanant et hostile de son environnement familial, villageois, scolaire, et qui finalement découvre qu’il y a d’autres manières de vivre que celle dans laquelle il était enfermé.
 En finir avec Eddy Bellegueule est une œuvre courageuse qui, à la manière des autobiographies de Michel Leiris, ne cherche pas à échapper aux risques personnels, qui les provoque même. Mais c’est aussi et surtout l’œuvre d’un écrivain. S’il y a du Zola dans l’évocation de la misère sociale, du Jules Renard (celui de Poil de Carotte) dans celle de l’enfance malheureuse, la division en brèves séquences donne à l’ensemble une visibilité théâtrale, quasiment cinématographique, tout en préservant le relief de la réalité. Souffrir et jouir, aimer et rejeter, s’attacher et fuir, mépriser et admirer – Édouard Louis, avec une précoce maturité, sait restituer toute la complexité des comportements humains.
En finir avec Eddy Bellegueule est une œuvre courageuse qui, à la manière des autobiographies de Michel Leiris, ne cherche pas à échapper aux risques personnels, qui les provoque même. Mais c’est aussi et surtout l’œuvre d’un écrivain. S’il y a du Zola dans l’évocation de la misère sociale, du Jules Renard (celui de Poil de Carotte) dans celle de l’enfance malheureuse, la division en brèves séquences donne à l’ensemble une visibilité théâtrale, quasiment cinématographique, tout en préservant le relief de la réalité. Souffrir et jouir, aimer et rejeter, s’attacher et fuir, mépriser et admirer – Édouard Louis, avec une précoce maturité, sait restituer toute la complexité des comportements humains.
Jean-Pierre Longre
16:52 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, autobiographie, francophone, Édouard louis, le seuil, points, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
Un père, malgré tout?
Pascal Bruckner, Un bon fils, Grasset, 2014 , Le Livre de Poche, 2015
, Le Livre de Poche, 2015
« Mon père m’a permis de penser mieux en pensant contre lui. Je suis sa défaite : c’est le plus beau cadeau qu’il m’ait fait ». Tel est le point de convergence des souvenirs et des réflexions dont est composé Un bon fils. Récit de vie paternelle ? Autobiographie ? Règlement de compte ? Essai de psychologie familiale ? Il n’y a pas à choisir : le livre est un peu tout cela, qui, entre narration discontinue et mosaïque de maximes philosophiques, en fait une œuvre littéraire.
En trois parties (« Le détestable et le merveilleux », « L’échappée belle », « Pour solde de tout compte ») et un épilogue-surprise, Pascal Bruckner développe le paradoxe du « bon fils » d’un père qui, dirait-on, fait tout pour être haï : mari brutal, pervers et infidèle, antisémite, xénophobe, pronazi s’empressant d’aller travailler pour l’ennemi, être despotique et imprévisible, puis exemple encore vivant de la décrépitude physique – s’accrochant envers et contre tout à son fils unique qui, en réaction, s’éloigne avec vigueur et passion d’une enfance inquiète. « Je me suis allégé de ma famille en m’alourdissant d’autres liens qui m’ont enrichi ».
 Le salut, pour le fils du tyran, ce sera d’abord la lecture. « Dans les livres, enfin, j’apprends la grammaire de la liberté grâce aux dieux de ma jeunesse, Sartre, Gide, Malraux, Michaux, Queneau, Breton, Camus. Je me construis à travers eux une forteresse inexpugnable ». Ce sera aussi la prise de l’indépendance et de la liberté (les voyages, les amours, le rejet des contraintes de l’existence bourgeoise). Et ce sera, bien sûr, l’écriture, ces livres qui font de Pascal Bruckner un auteur original, à la fois penseur (de ceux que l’on rangeait naguère parmi les « nouveaux philosophes ») et auteur de belles fictions romanesques. « Tant qu’on crée, tant qu’on aime, on demeure vivant ». Ce récit initiatique, qui ne s’arrête pas au simple dévoilement de secrets de famille, mais élargit le champ d’investigation à l’apprentissage de la vie, le prouve avec limpidité.
Le salut, pour le fils du tyran, ce sera d’abord la lecture. « Dans les livres, enfin, j’apprends la grammaire de la liberté grâce aux dieux de ma jeunesse, Sartre, Gide, Malraux, Michaux, Queneau, Breton, Camus. Je me construis à travers eux une forteresse inexpugnable ». Ce sera aussi la prise de l’indépendance et de la liberté (les voyages, les amours, le rejet des contraintes de l’existence bourgeoise). Et ce sera, bien sûr, l’écriture, ces livres qui font de Pascal Bruckner un auteur original, à la fois penseur (de ceux que l’on rangeait naguère parmi les « nouveaux philosophes ») et auteur de belles fictions romanesques. « Tant qu’on crée, tant qu’on aime, on demeure vivant ». Ce récit initiatique, qui ne s’arrête pas au simple dévoilement de secrets de famille, mais élargit le champ d’investigation à l’apprentissage de la vie, le prouve avec limpidité.
Jean-Pierre Longre
14:47 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, autobiographie, récit, pascal bruckner, grasset, le livre de poche, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
06/12/2015
Boccace au bistrot
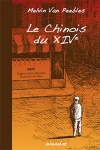 Melvin Van Peebles, Le Chinois du XIVe. Préface d’André Hardellet, illustrations de Topor, Wombat, 2015
Melvin Van Peebles, Le Chinois du XIVe. Préface d’André Hardellet, illustrations de Topor, Wombat, 2015
Dans le Décaméron, Boccace (1313-1375) imagine que dix jeunes gens et jeunes filles, isolés dans une villa à cause de la peste qui sévit à Florence, consacrent dix journées à se raconter des histoires de toutes sortes. Dans Le Chinois du XIVe, la villa de Toscane est remplacée par Mon Moulin, bistrot du quatorzième arrondissement de Paris, la peste devient une coupure d’électricité provoquée par la grève, et les conteurs sont des « petits », des gens du peuple parisien des années 1960, dont les histoires sont tirées de leur expérience, de leurs rêves, de leur imagination…
Il y a là, par exemple, un veilleur de nuit inquiet de la puissance des savants, un clochard qui a laissé filer le grand amour par ambition, un représentant suggérant mine de rien le moyen de régler radicalement les problèmes familiaux, une bonne à tout faire réincarnation de l’immaculée conception, le patron du troquet et sa femme, aux souvenirs d’enfance où les chiens jouent un rôle, d’autres encore… Le fameux Chinois, lui, joue les Arlésiennes dès le début ; il a disparu de la circulation, et finalement au bout de quelques jours il n’est plus question de lui, sinon dans le titre du livre.
Un livre par ailleurs impossible à résumer – ou alors il faudrait raconter toutes les histoires qu’échangent les convives autour d’une table éclairée par une lampe à pétrole. Des histoires dans lesquelles la réalité, avec ses grand malheurs et ses petits bonheurs, ses tristesses et ses joies, avec les colères et la solidarité que tout cela suscite, la réalité, donc, côtoie allègrement les rêves d’une autre vie, les fantasmes et les cauchemars. Le Chinois du XIVe est un livre d’atmosphère (à laquelle contribuent largement les illustrations de Topor), écrit par un Américain éclectique, musicien, cinéaste, traducteur et, bien sûr écrivain « d’expression française », une « expression » originale, dans tous les sens du terme – disons à la fois de pure origine populaire et sortant de l’ordinaire. Narration et poésie, burlesque et pathétique, suspense et sagesse, étrange et pittoresque – un beau mélange des genres pour une lecture d’une réjouissante variété.
Jean-Pierre Longre
22:15 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, conte, francophone, melvin van peebles, andré hardellet, topor, wombat, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
À la poursuite du vibrion cholérique
 Anne Roiphe, L’insaisissable, traduit de l’anglais (États-Unis) par Blandine Longre, Les éditions du Sonneur, 2015
Anne Roiphe, L’insaisissable, traduit de l’anglais (États-Unis) par Blandine Longre, Les éditions du Sonneur, 2015
En 1883, une épidémie de choléra sévit à Alexandrie. Louis Pasteur confie à de jeunes chercheurs français la mission de partir dans la ville égyptienne afin de traquer et d’identifier le microbe responsable de la maladie qui a ravagé de nombreuses régions du monde au cours des siècles. À partir de ce fait scientifique, Anne Roiphe, journaliste et écrivain née en 1935 aux États-Unis, a composé une épopée romanesque dans laquelle vérité historique et suspense narratif se répondent et se mêlent intimement.
Le contexte géographique, campé avec précision et pittoresque, est donc celui d’Alexandrie à la fin du XIXe siècle, ville grouillante de vie malgré l’épidémie, cité où se mêlent l’antique et l’actuel, port cosmopolite où se côtoient les communautés de diverses origines, de diverses religions – avec ce que cela implique d’amitiés sincères mais aussi de rivalités et de trafics en tous genres. Il y a encore le contexte médical, dans lequel émergent des personnes réelles (l’équipe des chercheurs français et celle des chercheurs allemands menée par le fameux Robert Koch), mais aussi des personnages fictifs comme le docteur Malina, honorable médecin juif renommé dans la ville, qui avec sa famille sera victime du machiavélisme des Anglais, et dont la fille, Este, va devenir l’héroïne féminine du roman. Car un amour réciproque naît peu à peu entre la jeune fille et Louis Thuillier, membre du petit groupe de français qui a installé son laboratoire dans l’hôpital européen de la ville – et cet amour va de pair avec l’intérêt grandissant d’Este pour le travail de recherche médicale. D’autres personnages nés sous la plume de la romancière jouent des rôles qui, bien qu’ils paraissent secondaires, changent radicalement le cours du récit : tels le jeune Marcus, aide de laboratoire en quête de fortunes faciles, Eric Fortmann, aventurier hâbleur et sans scrupules, ou Albert, initialement fiancé à Este…
Pour historique qu’il soit, L’insaisissable est donc un vrai roman, une fiction dans laquelle les sentiments, les passions et les manœuvres nouent des destins dramatiques. De surcroît, l’aspect documentaire, assuré par des extraits de lettres de Pasteur et d’ouvrages spécialisés, ainsi que par de minutieuses descriptions des corps malades et des expériences de laboratoire, est rehaussé par les épisodes qui font du mystérieux microbe un être vivant et invisible s’insinuant dans l’eau, les humeurs, les tissus, les organes, les moindres recoins de la ville, des rues, des maisons et des corps, une sorte de fantôme morbide et diabolique qui exerce ses ravages de manière subreptice, imprévisible et fatale. Et ceux qui le traquent risquent bien d’être à leur tour traqués, d’en devenir les victimes. Insaisissable, jusqu’au bout.
Jean-Pierre Longre
17:43 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, anglophone, anne roiphe, blandine longre, choléra, louis pasteur, robert koch, les éditions du sonneur, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
« Parvenir à quelque chose »
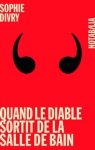 Sophie Divry, Quand le diable sortit de la salle de bain, Notabilia / Les Éditions Noir sur Blanc, 2015
Sophie Divry, Quand le diable sortit de la salle de bain, Notabilia / Les Éditions Noir sur Blanc, 2015
Voilà bien un roman contemporain, dans tous les sens du qualificatif. Sa période de publication correspond fidèlement à la condition de nombreux trentenaires d’aujourd’hui : combiner les contraintes du dénuement financier (le chômage, les factures qui continuent d’arriver, la recherche de nourriture et de vêtements, les reproches ou les interrogations de la famille, les comptes pathétiques de fin de mois…) avec les exigences culturelles et sociales d’une âme généreuse, d’un esprit lucide et critique, d’un cœur en quête d’affection et d’amitié.
Entendons-nous : Quand le diable sortit de la salle de bain n’est pas une étude sociologique. C’est mieux que cela. La narratrice comble sa misère matérielle en racontant, sur un mode plus humoristique que dramatique, ses déboires, ses espoirs, ses déceptions, ses joies aussi, l’amitié parfois éprouvante qui la lie à Hector (gentil obsédé sexuel), les apparitions de Lorchus, son démon littéraire, les interruptions imaginaires ou réelles de ses proches (sa mère surtout), les visites à Pôle Emploi, le séjour méridional dans le cocon nourricier de la famille, le retour à Lyon, les difficultés du métier de serveuse – car il faut bien, un jour, se mettre à travailler en renonçant à « toute ambition personnelle », en tentant tout de même de « parvenir à quelque chose ».
Roman très actuel, donc, qui se lit avec un pur plaisir. Récit en trois parties, « roman improvisé, interruptif et pas sérieux » (sous-titre donné par l’auteure elle-même) ? « Improvisé » en apparence, en réalité construit ; « interruptif », certes, mais avec un bon fil conducteur ; « pas sérieux », tout est relatif : le sujet est grave, le style alerte, l’allure rieuse, la narration pleine de références littéraires, et toutes les ressources de la typographie sont mises à contribution: tableaux, calligrammes, listes, colonnes, dialogues simultanés, schématisation – insérée dans l’écriture – des positions corporelles et des dispositions mentales (sur un lit, par exemple, le personnage désespéré contemplant le plafond), sigles et signes divers… Et, comme dans les DVD, un « bonus » avec « index des principaux auteurs cités, pillés ou dissous », traces d’une quatrième partie, « note d’intention ». Sophie Divry a du métier et, bien plus, du talent.
Jean-Pierre Longre
13:00 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, sophie divry, notabilia, les Éditions noir sur blanc, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
« En faveur de la lecture »
 Jean-Jacques Nuel, Billets d’absence, Le Pont du Change, 2015
Jean-Jacques Nuel, Billets d’absence, Le Pont du Change, 2015
Il y a eu les Courts métrages, il y a maintenant les Billets d’absence, comme de petits mots signalant que l’on est toujours là, même si la « séparation de corps » (titre du premier texte) signale un éloignement de soi, une prise d’indépendance. Jean-Jacques Nuel est toujours présent, dans une sorte de dédoublement, le trait d’union entre Jean et Jacques prenant parfois de drôles d’allure et le choix entre l’espace et le temps étant parfois difficile à faire.
La longueur des textes varie entre trois lignes et une page. C’est suffisant pour que s’y logent les surprises, l’humour (noir, rose ou les deux à la fois), les réflexions sous forme d’anecdotes légères ou tragiques (en particulier sur le livre, la littérature, la lecture), l’absurde, la poésie. Oui, quelques mots suffisent pour laisser une belle image onirique s’imposer à l’esprit (par exemple : « La ligne de flottaison du rêve était si basse que le dormeur risquait à tout moment, s’il se retournait trop fort dans son lit, de sombrer. ») ; ou pour livrer quelques confidences sur le temps qui passe, sur la mort, sur la vie, confidences qui, si personnelles qu’elles soient, concernent tout un chacun ; ou encore pour cibler quelque défaut flagrant de la société humaine.
Passent au fil des pages quelques auteurs fameux : Schopenhauer, Emily Brontë, Faulkner, Isidore Ducasse (en compagnon de route), Kafka (bien sûr), Jacques Sternberg (sans doute, en filigrane) ; mais surtout Jean-Jacques Nuel, qui, comme naguère l’ami Pierre Autin-Grenier, voue une sorte de culte mitigé au ratage, à l’échec, jusqu’à s’étonner d’être lu : « Le timide succès qui semble commencer à se dessiner aujourd’hui me perturbe et ne laisse pas de m’inquiéter : quelle erreur ai-je bien pu commettre pour plaire enfin et trouver sur le tard un public ? ». Eh bien, cher écrivain, pas d’étonnement ! Si succès il y a, il est mérité. Et vos « billets d’absence » participent sans conteste à « une politique en faveur de la lecture ».
Jean-Pierre Longre
12:00 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, poésie, francophone, jean-jacques nuel, le pont du change, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
05/12/2015
Irrésistibles élans
 Nicolas Cavaillès, Pourquoi le saut des baleines, Les éditions du Sonneur, 2015
Nicolas Cavaillès, Pourquoi le saut des baleines, Les éditions du Sonneur, 2015
La question est-elle absurde ? Pas plus que le geste sur lequel elle porte. Pas moins non plus. En réalité, écrit l’auteur, « nous ignorons pourquoi les baleines et autres cétacés effectuent parfois ces sauts stupéfiants au-dessus des mers et des océans, mais les hypothèses ne manquent pas, elles se renforcent même du fait que la question n’a pas été tranchée. ». Une fois évacuée (mais non définitivement écartée) l’éventualité du saut « quia absurdum », qui serait peut-être la preuve de l’esprit philosophique des baleines, nous avons droit, après une revue de « détail » des différentes familles de cétacés, au développement de toutes les réponses possibles à la question que posent les bonds étranges, inattendus, violents, différents selon les espèces, des baleines hors de l’eau.
Nicolas Cavaillès, pour l’occasion, se livre à toutes les hypothèses, depuis les explications (contestées) des Vikings (« Un moyen de se déplacer plus facilement, et de détruire les navires ») jusqu’aux élucubrations sur le caractère érotique des sauts collectifs (« orgies de caresses, ébats en groupe »). Chemin faisant, nous apprenons de bonnes et belles choses sur la vie et la mort, le tempérament et la physiologie de ces êtres fascinants, nous plongeons dans les études aristotéliciennes sur la locomotion animale, en surgissons pour tomber sur un chapitre hautement mathématique, empli de formules fondées sur la « poussée d’Archimède »…
Par-dessus tout, ce qui paraît être un bref essai scientifique mâtiné de rappels historiques et de détachement fantaisiste, voire humoristique, est aussi une méditation sous-tendue par la réflexion philosophique et le sentiment artistique. La Bible, Kierkegaard, Nietzsche sont sollicités, et aussi Herman Melville (bien sûr pour Moby Dick), Dostoïevski, Glenn Gould et son interprétation des Variations Goldberg… Cela pour dire que le mammifère aquatique voudrait aussi être aérien, aspire comme le mammifère humain, entre la naissance et la mort, à échapper à la « fadeur de l’existence » et à pénétrer dans « le Grand Tout homogène où le ciel et la mer ne font qu’un, sans hiérarchie ni haut ni bas, partageant de mêmes flux magnétiques sans distinction entre les quatre points cardinaux d’une planète ronde. ». Pourquoi Nicolas Cavaillès a-t-il cherché des réponses à la question du « saut des baleines » ? Sans doute pour mieux poser celle, tout aussi énigmatique, de l’existence humaine. Allez savoir…
Jean-Pierre Longre
Nicolas Cavaillès, spécialiste de Cioran, traducteur du roumain, éditeur, écrivain, a obtenu le Prix Goncourt de la nouvelle en 2014 pour Vie de Monsieur Leguat (Les éditions du Sonneur).
Voir http://jplongre.hautetfort.com/tag/nicolas+cavaillès
14:55 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, roman, francophone, nicolas cavaillès, les éditions du sonneur, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
Une assourdissante absence
 Pascal Herlem, La soeur, L’arbalète Gallimard, 2015
Pascal Herlem, La soeur, L’arbalète Gallimard, 2015
Le premier mot du titre, en deux lettres, en dit déjà long : ni « ma », ni « notre » ; « la » sœur n’appartient à personne, à peine à la famille, cette « sœur aînée, presque une inconnue. Une sœur qu’en croyant bien faire on a lobotomisée », cette sœur dont l’auteur écrit : « Je l’ai toujours connue ainsi, absente ».
Absente, mais sans cesse présente d’une manière ou d’une autre, pendant et après l’enfance, dans une famille dominée par « la » mère (toujours cette non appartenance). Pascal Herlem puise dans ses souvenirs d’enfant et d’adulte, mais aussi dans trois récits laissés par la mère, « trois récits glaçants » qui composent quelque peu avec la vérité, sans occulter les faits : la lobotomie qui ne résoudra rien, les hospitalisations, les périodes de crise, la disparition de Françoise dans différentes maisons où elle restera enfermée loin de ses deux frères qui paraissent s’accommoder de cette absence, de ce silence en réalité assourdissant. Une sorte de mort par anticipation – et la découverte finale en est pour ainsi dire une attestation.
Racontant l’histoire de Françoise, l’auteur raconte sa propre histoire et celle des siens, remontant aux « origines » d’une famille déclassée, dans laquelle la bâtardise, la mort, la folie voudraient être effacées par les rêves de réhabilitation sociale de la mère, comme par les « arrangements », les non-dits et l’enfouissement des secrets. De surcroît, l’étrange (ou compréhensible ?) effacement du père devant l’omniprésence de la mère est une constante, jusqu’à la fin : « Papa n’est pas là, il est ailleurs, on ne sait pas où ». Bref, tout cela méritait d’être raconté, et Pascal Herlem le fait avec une courageuse sincérité, sans complaisance mais sans animosité, avec une sensibilité tout en retenue qui n’exclut ni la prise de distance, ni l’esquisse d’explications socio-psychologiques, ni, surtout, un travail de mise en ordre littéraire. La force du sujet et de son traitement qui laisse percer de tendres et tenaces regrets, le choix précis des mots, la belle et suggestive limpidité du style font de La sœur un livre que l’on ne peut oublier.
Jean-Pierre Longre
10:20 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, autobiographie, pascal herlem, gallimard, l’arbalète, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
04/12/2015
Explosante-fixe
 Irina Teodorescu, Les étrangères, Gaïa, 2015
Irina Teodorescu, Les étrangères, Gaïa, 2015
Le nouveau roman d’Irina Teodorescu ne laisse pas le lecteur en repos ; c’est tant mieux. De l’image à jamais fixe de la photographie à l’incessant mouvement circulaire de la danse, il doit se frayer son chemin, le lecteur. Et entre les deux formes artistiques, une troisième s’impose, qui fait le lien : la musique, sonore ou silencieuse. En outre, il y a les voyages, les va-et-vient entre Bucarest et Paris, entre la ville étrange et reposante de Kalior (la plus belle, sans doute) et l’Europe – et par-dessus tout, l’amour.
La narration est multiple, en instantanés, en spirales, en arrêts sur image, en bonds, autour des deux protagonistes. Il y a d’abord Joséphine, petite puis jeune fille franco-roumaine, élevée sous la dictature de Ceauşescu mais pouvant circuler, avec ses parents, entre la Roumanie et la France. Amoureuse de sa professeure de violon, puis passionnée de photographie, elle sacrifie ses études et ses diplômes à cette passion qui lui vaut un succès international. Et c’est le grand amour : celui de Nadia, la ronde danseuse, avec qui elle va tout partager (la vie, l’art, les voyages, les confidences), et qui va peu à peu se raconter elle-même, raconter leur existence fusionnelle. « Pendant quatre ans, Joséphine et moi fûmes un seul corps. Comme des amantes siamoises. ». Puis les séparations, les retours, la fuite solitaire vers un ailleurs situé entre veille et rêve, un espace à la fois mouvant et immobile.
Les étrangères (aux autres, à elles-mêmes, au monde) est un roman de l’entre-deux (entre deux pays, entre deux langues, entre deux arts, entre deux femmes, entre réel et imaginaire, entre fusion et séparation…) et de la quête d’un absolu artistique : photographier l’invisible (la musique, l’intérieur des gens), danser sur le silence, fixer le mouvement – comme l’image « explosante-fixe » de la « beauté convulsive » chère à André Breton. C’est aussi, et surtout, le roman d’une écriture ; celle d’une auteure qui a appris la langue française à l’âge de 19 ans, et qui quinze ans plus tard parvient à la maîtriser au point de la rendre malléable, et, tout au long de ces 200 pages, d’adapter son style à celui des protagonistes, de leur âge, de leurs préoccupations, de leur tempérament. Laisser leur liberté d’expression à ses personnages, voilà un bel idéal romanesque.
Jean-Pierre Longre
http://www.arte.tv/magazine/metropolis/fr/irina-teodoresc...
16:14 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, roumanie, irina teodorescu, gaïa-éditions, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
Lointain familier
 Jean-Luc Sahagian, Varduhi Sahagian, Gumri, Arménie, si loin du ciel… Ab irato, 2015
Jean-Luc Sahagian, Varduhi Sahagian, Gumri, Arménie, si loin du ciel… Ab irato, 2015
La grand-mère (« Tamam ») de Jean-Luc Sahagian, fuyant la Turquie après le génocide des Arméniens en 1915, se retrouva un jour à Marseille, et c’est ainsi que son petit-fils est un Arménien de France (ou un Français d’origine arménienne ?). Longtemps après, il décide de partir pour Gumri, ville du Nord-Ouest de l’Arménie, où son père s’était rendu après le tremblement de terre de 1988, peu avant la fin de l’Union Soviétique.
L’Arménie est pour lui « non pas une terre d’identité, de racines, mais une étrangeté peut-être familière ». Accueilli avec la bienveillance orientale que l’on manifeste là-bas aux visiteurs, Jean-Luc raconte ses découvertes, ses rencontres – dont celle de l’amour – et ce livre est le fruit « de deux regards » complémentaires, le sien et celui de « Rose » (Varduhi), qui donne en artiste sa vision dessinée de Gumri, vue de l’intérieur.
Il ne s’agit ni pour l’un ni pour l’autre de verser dans le pittoresque exotique, mais de décrire avec vivacité, tendresse, humour la vie quotidienne d’une ville qui a été durement éprouvée par la dictature soviétique, le tremblement de terre meurtrier et destructeur, le capitalisme sauvage entraînant l’émergence des mafias et des disparités sociales – sans parler du souvenir latent du génocide –, une ville où beaucoup rêvent d’ailleurs, mais à laquelle la solidarité, un « fort sentiment de communauté », le sens de la fête et du rire donnent une coloration pleinement humaine. L’auteur, dans ses allées et venues à Gumri, au-delà de tous les inconforts, de toutes les contraintes matérielles, va s’y trouver « en pays de connaissance » et s’y attacher profondément. « Bien sûr, l’Arménie est dure à vivre pour ses habitants et cette dureté est renforcée encore par la douleur profonde de son histoire. Mais on trouve aussi tellement de raisons d’y être heureux malgré tout… ». Bien mieux qu’un guide touristique, ce beau livre, texte et dessins combinés, incite à aller voir là-bas, « à quatre mille kilomètres de la France. ».
Jean-Pierre Longre
14:02 Publié dans Essai, Mots et images | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, récit, dessin, francophone, arménie, jean-luc sahagian, varduhi sahagian, ab irato, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
« Nous n’irons plus nus »
 Christophe Girard, Le linceul du vieux monde. La révolte des canuts, livre 3, Les enfants rouges, novembre 2014
Christophe Girard, Le linceul du vieux monde. La révolte des canuts, livre 3, Les enfants rouges, novembre 2014
Novembre 1831 fut, à Lyon, un mois particulièrement tourmenté, fiévreux, sanglant, un mois qui a marqué une étape décisive dans l’histoire de la ville comme dans celle du mouvement ouvrier. Les deux premiers livres de La révolte des canuts racontaient les prémices de cette révolte, les injustices, les premières manifestations, la répression dans des images et des dialogues aussi expressifs que vigoureux (voir ici).
Cette vigueur et cette expressivité, on les retrouve, toujours en noir et blanc, dans le livre 3 sous-titré « À l’aube du rêve ». Un rêve qui, dans l’immédiat, restera à l’état de belle illusion pour laquelle tant de sang d’ouvriers (mais aussi de soldats et de « victimes collatérales ») aura coulé. Un rêve, tout de même, que les dernières images (un dialogue, trente ans plus tard, entre Karl Marx et le journaliste Pétretin) signalent comme les débuts de la défense du prolétariat ; un rêve que chantera, encore plus tard, Aristide Bruant : « Mais notre règne arrivera / Quand votre règne finira ».
Voilà donc un album historiquement décisif, plein d’enseignements sur la tournure qu’ont prise les événements : violences, rivalités humaines et politiques, clivage entre l’idéal républicain et les revendications catégorielles, mainmise des pouvoirs locaux et surtout du pouvoir central incarné par Louis-Philippe et par ses envoyés… L’histoire est complexe, les rebondissements et les revirements sont nombreux, les événements s’imbriquent les uns dans les autres, mais le genre de la bande dessinée aide à s’y retrouver – à condition, comme c’est le cas ici, que le texte soutienne abondamment le dessin, explicitant les enjeux, les manœuvres, les indignations, mettant en relief les portraits pittoresques aux traits marqués. Et au milieu des noms plus ou moins connus, des souvenirs plus ou moins effacés, se glissent quelques allusions malicieuses à des situations encore bien actuelles, tel le cumul des mandats (« Vous faites partie de cette nouvelle espèce de parlementaires, ces cumulards qui prospèrent et qui à force de trop vouloir faire ne font rien mais gagnent beaucoup »), ou des détournements d’œuvres notoires comme L’Angélus de Millet…
Avec les trois livres du Linceul du vieux monde, Christophe Girard met en perspective le passé local et national, rend l’Histoire accessible à tous. Instruire en divertissant, c’est toujours la bonne formule…
Jean-Pierre Longre
10:07 Publié dans Mots et images | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, francophone, histoire, lyon, christophe girard, les enfants rouges, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
03/12/2015
Le petit blond en Syrie
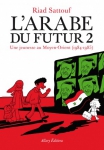 Riad Sattouf, L’Arabe du futur 2. Une jeunesse au Moyen-Orient (1984-1985), Allary Éditions, 2015
Riad Sattouf, L’Arabe du futur 2. Une jeunesse au Moyen-Orient (1984-1985), Allary Éditions, 2015
La renommée de Riad Sattouf n’est plus à faire (voir par exemple La vie secrète des jeunes, Ma circoncision ou Les cahiers d’Esther,l’impayable feuilleton hebdomadaire du Nouvel Observateur), et le deuxième volume de L’Arabe du futur la justifie encore, cette renommée. Dans la Syrie de 1984, sous le règne d’Hafez Al-Assad, le petit Riad, six ans, fait ses débuts à l’école sous la férule de maîtres intraitables, se frotte à la vie sociale et à ses vicissitudes, à la vie familiale entre une mère bretonne et un père arabe, des cousins, des oncles et tantes, quelques représentants de classes sociales intrigantes (dans tous les sens du terme)…
 Il faut voir et lire cette autobiographie savoureusement dessinée, vivement dialoguée, cette autoreprésentation d’un petit garçon qui découvre la vie de sa hauteur, avec une naïveté malicieuse, d’un petit garçon qui s’étonne, s’adapte, s’amuse, s’émeut, comprend avec sa finesse d’enfant certains rouages de la société. Et tout cela sans parti-pris, sans manichéisme, mais avec une tendresse qui n’exclut ni le pittoresque des personnages, ni les regards lucides, ni les sous-entendus satiriques. Comme le petit Riad, avec lui, on s’étonne, on s’amuse, on s’émeut, on comprend toutes sortes de choses, et ces 150 pages de BD (ou roman graphique), à leur manière, nous en apprennent au moins autant qu’un ouvrage d’histoire contemporaine ou un reportage – le rire et le sourire en prime. Vivement la suite (et en attendant, relisons le premier volume)…
Il faut voir et lire cette autobiographie savoureusement dessinée, vivement dialoguée, cette autoreprésentation d’un petit garçon qui découvre la vie de sa hauteur, avec une naïveté malicieuse, d’un petit garçon qui s’étonne, s’adapte, s’amuse, s’émeut, comprend avec sa finesse d’enfant certains rouages de la société. Et tout cela sans parti-pris, sans manichéisme, mais avec une tendresse qui n’exclut ni le pittoresque des personnages, ni les regards lucides, ni les sous-entendus satiriques. Comme le petit Riad, avec lui, on s’étonne, on s’amuse, on s’émeut, on comprend toutes sortes de choses, et ces 150 pages de BD (ou roman graphique), à leur manière, nous en apprennent au moins autant qu’un ouvrage d’histoire contemporaine ou un reportage – le rire et le sourire en prime. Vivement la suite (et en attendant, relisons le premier volume)…
Jean-Pierre Longre
20:03 Publié dans Mots et images | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, francophone, riad sattouf, allary Éditions, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
« L’étincelle de nos espoirs »
 Jacques Baujard, Panaït Istrati. L’amitié vagabonde, Transboréal, 2015
Jacques Baujard, Panaït Istrati. L’amitié vagabonde, Transboréal, 2015
Une biographie supplémentaire de Panaït Istrati ? Celle de Monique Jutrin, récemment rééditée (voir ici ou là) ne suffisait-elle pas ? Sur le plan documentaire, si, bien sûr. C’est une somme. Mais le livre de Jacques Baujard est d’un autre genre – outre le fait qu’il confirme la renaissance d’un écrivain qui, c’est justice, reprend sa place dans le paysage littéraire européen.
Un écrivain qui est aussi un personnage romanesque. Et de fait, cette biographie, tout en répondant aux critères du genre (les grands événements de la vie, les ouvrages, la chronologie, des documents, une carte des voyages…), se lit comme un roman. Car l’auteur ne se contente pas de reconstituer la vie d’un autre. Il raconte comment lui-même ressent cette vie, comment Panaït Istrati, qu’il a découvert, jeune libraire, par le hasard d’une commande faite par un client négligent, est devenu pour lui un ami qu’il a suivi à la trace dans ses œuvres et, sur place, dans son pays d’origine, qu’il a parcouru par la même occasion.
La destinée d’Istrati, on le sait, est pleine de péripéties, de malheurs, de bonheurs, de désespoirs, d’espoirs, de rebonds. L’homme a souffert, a aimé, a beaucoup travaillé, bourlingué, s’est toujours battu – pour vivre, pour apprendre le français, pour changer le monde, pour les autres –, en dehors des sentiers battus, des dogmes et des schémas tout faits (ou disons que de ceux-ci, il est revenu, constatant que la liberté et l’amitié sont les vrais critères, ce qui lui a valu la haine des idéologues de tous bords). Jacques Baujard nous rappelle tout cela, se référant maintes fois à l’œuvre du conteur, à sa correspondance, à ses réflexions, et nous donnant en prime, en de beaux et émouvants mélanges finaux, des aperçus de « l’univers de Panaït Istrati » - ses amis, ses amours, ses lectures, ses métiers, ses personnages, bien d’autres choses encore.
Surtout, on sent une profonde connivence entre le libraire libertaire d’aujourd’hui et l’écrivain vagabond mort en 1935. C’est un dialogue entre amis qui s’établit, en des écritures qui tendent à se confondre, départagées par les seuls guillemets, le tout aboutissant à une profession de foi commune. « De la même manière que Panaït Istrati, il vaut mieux se concentrer sur des valeurs universelles. Prôner la tolérance afin de se rassembler plutôt que de se déchirer. Vagabonder à travers les différentes cultures de la planète pour élargir nos horizons et comprendre un peu mieux le monde dans lequel on vit. Plus que toute autre chose, hisser bien haut l’étendard de l’amitié. La donner au premier venu avec passion. La partager au milieu des verres, des rires, des pleurs et des beaux souvenirs. Avoir confiance en l’homme et ses limites, plutôt qu’en la machine. […] Et ma foi, malgré le désespoir ambiant et même si la partie semble jouée d’avance, il faut à tout prix avoir confiance en ses capacités et entretenir l’étincelle de nos espoirs. ».
Jean-Pierre Longre
18:44 Publié dans Essai | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, biographie, francophone, roumanie, jacques baujard, panaït istrati, transboréal, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
Images d’une passion musicale
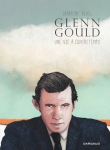 Sandrine Revel, Glenn Gould. Une vie à contretemps, Dargaud, 2015
Sandrine Revel, Glenn Gould. Une vie à contretemps, Dargaud, 2015
Est-il possible de percer « le mystère Glenn Gould » (disons plutôt les mystères, tant le personnage paraît complexe)? Pas vraiment. Mais l’album graphique de Sandrine Revel fournit des approches à la fois esthétiquement séduisantes et intellectuellement convaincantes. Il est rare qu’une biographie de célébrité pénètre à ce point dans la personnalité, dans les secrets même de son protagoniste. L’auteure, dans cette perspective, utilise avec à-propos et talent les ressources de la bande dessinée.
La narration ne se contente pas de raconter. Ou si elle le fait, c’est dans un constant va-et-vient entre les différentes périodes (enfance, concerts, enregistrements, voyages, accidents de santé, relations amicales et amoureuses, fuites, retours…), entre la vie réelle avec ses vicissitudes et ses instants de bonheur, et la vie rêvée avec ses illusions et ses cauchemars, entre les interviews du musicien et les témoignages de ses proches. Ainsi, l’essentiel est dit, à la fois dans le texte écrit et dans le silence des dessins.
Car l’avantage du genre bien exploité est de faire passer par l’image ce que les mots ne peuvent pas exprimer : les visions, les délires, les souvenirs, l’hypocondrie, l’isolement (qu’accompagnent l’amour des animaux, le goût pour les immensités, « l’aspect nordique de l’être humain » et « les ciels nuageux »). Surtout – et ce peut être considéré comme une gageure – l’image (traits, dessins, couleurs, dimensions) réussit à montrer la musique : attitudes physiques du pianiste dans toute leur originalité, expressivité du visage, mouvements des mains sur le clavier (des planches entières montrent les différentes positions des doigts, si bien observées, si bien reproduites), sans parler de l’exigence absolue de Glenn Gould dans le choix de son piano, de son siège, des appareils d’enregistrement…
Pas d’explications rationnelles, pas de détails superflus, pas de descriptions gratuites, pas de récit linéaire. Mais l’album suggère parfaitement cette « vie à contretemps » d’un être pour qui la perfection musicale est un idéal, une passion, voire une obsession vers lesquels tendent tous les instants de son existence, jusqu’à l’effacement. Et l’ultime but, qu’il définit lui-même : « La musique pour l’auditeur comme pour l’interprète doit amener à la contemplation. ».
Jean-Pierre Longre
16:29 Publié dans Mots et images | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, biographie, musique, glenn gould, sandrine revel, dargaud, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
« Le mystère d’Edward Hopper »
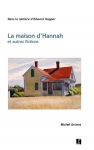 Michel Arcens, La maison d’Hannah et autres fictions, Alter Ego Éditions, 2015
Michel Arcens, La maison d’Hannah et autres fictions, Alter Ego Éditions, 2015
Les vingt textes que Michel Arcens propose « dans la lumière d’Edward Hopper » ne sont ni des descriptions ni des commentaires de tableaux. Serait-il d’ailleurs possible pour un écrivain de traduire en mots ce que seule la peinture sait dire et sous-entendre ? L’artiste lui-même jugeait vaine toute tentative de ce genre. Non : l’intention avouée de Michel Arcens est de « pénétrer dans la peinture de Hopper » en lui apportant une part « mystérieuse », « inconnue », secrète de soi-même.
Pas de méprise : il ne s’agit pas de confession intime, de journal personnel ou esthétique. Il s’agit de rester dans les limites imposées par les toiles ici reproduites, dans leur immobilité, leur luminosité, leurs couleurs, leurs perspectives, leurs motifs (personnages en attente, bâtisses isolées, étendues marines ou campagnardes, paysages citadins…). Mais dans ces limites mêmes, la profondeur des tableaux sollicite l’imagination, la puissance du rêve, le mouvement narratif, qui eux-mêmes suscitent la poésie et le récit.
Cela donne des nouvelles qui sont comme des illustrations verbales, de délicats prolongements de l’œuvre peinte, et qui provoquent chez celle-ci des pulsions parfois inattendues. De ces toiles qui en surface paraissent figées (ce que confirment le style et la teneur des extraits descriptifs), l’auteur sait, à partir de sa propre expérience, de sa sensibilité personnelle et de références littéraires identifiées, extirper l’histoire singulière de personnages plus ou moins inventés, les sensations physiques, les mouvements de la nature cosmique, minérale, végétale, ceux du temps qui passe, voire les parfums, la musique et la danse. Illusions ? Sans doute, mais illusions heureuses. Hannah a disparu, mais : « C’est un prodige étrange qu’Hannah soit ici, maintenant, présente, vibrante, heureuse. Elle passe lentement ses doigts sur mes paupières, puis ma bouche, jusqu’au menton. Elle pose ses lèvres sur les miennes, entrouvertes de tant de merveilles… ». Ces merveilles, ce sont celles de la peinture et de l’écriture conjuguées.
Jean-Pierre Longre
14:11 Publié dans Littérature, Mots et images | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, francophone, peinture, edward hopper, michel arcens, alter égo éditions, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |

